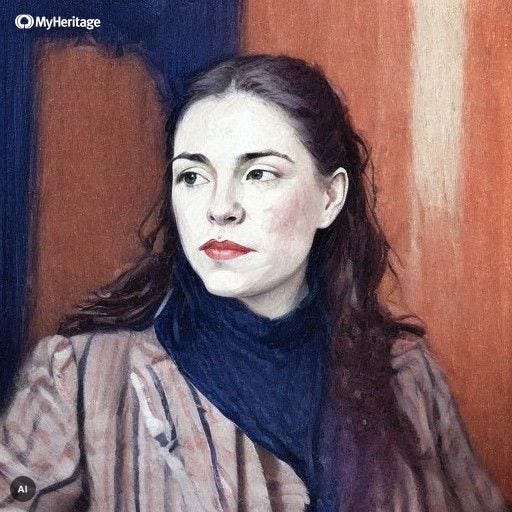La montée en Allemagne de la BSW de Sarah Wagenknecht et de l'AfD
Article rédigé le 25 janvier 2025 par Nel sur son compte Substack
Comment le désespoir économique, l’anxiété culturelle et l’échec du centrisme remodèlent la plus grande démocratie d’Europe
25 janv. 2025
Une nation divisée
Le paysage politique allemand est en pleine mutation. Le consensus centriste autrefois stable – ancré par le SPD et la CDU – s’effrite, remplacé par une lutte polarisée entre le nouveau parti de gauche Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) de Sahra Wagenknecht (BSW) et l’Alternative für Deutschland (AfD) d’extrême droite. Cette fragmentation met au jour des fractures plus profondes : un État-providence en recul, la mondialisation affectée exigeant réparation et un public désabusé par des décennies de réformes néolibérales et de politiques identitaires.
Alors que l’AfD fait la une des journaux en tant que deuxième plus grand parti d’Allemagne, le BSW représente une rébellion plus silencieuse – une tentative de relancer la politique de classe à une époque de guerres culturelles. Mais l’un ou l’autre mouvement peut-il guérir les divisions de l’Allemagne ?
La création d’un franc-tireur – Sarah Wagenknecht et la naissance de BSW
De socialiste est-allemande à incendiaire
de gauche, la carrière de Sarah Wagenknecht reflète le parcours idéologique de l’Allemagne. Ancienne membre du Parti socialiste unifié (SED) d’Allemagne de l’Est, elle est passée au PDS après la réunification et a ensuite codirigé Die Linke, le parti de gauche phare de l’Allemagne. Connue pour ses critiques marxistes du capitalisme et sa rhétorique acérée, Wagenknecht est devenue une figure polarisante, défendant la redistribution des richesses et le pacifisme tout en se heurtant aux progressistes sur l’immigration et la politique identitaire.La trahison du SPD et l’effilochage de Die Linke
Pour comprendre l’ascension de BSW, nous devons revisiter le pacte faustien du SPD avec le néolibéralisme. Sous le chancelier Gerhard Schröder (1998-2005), le SPD a abandonné ses racines ouvrières, embrassant la déréglementation et l’austérité à travers l’Agenda 2010 et les réformes Hartz IV. Ces politiques ont vidé les allocations de chômage, normalisé les « mini-emplois » précaires et légitimé les récits médiatiques déplorant les pauvres comme étant « paresseux ». Le résultat ? Une hémorragie d’électeurs du SPD vers Die Linke, un parti né en 2007 de la fusion du PDS d’Allemagne de l’Est et du WASG (Parti du travail et de la justice sociale) des anciens membres du SPD.Mais Die Linke a également vacillé. Dans les années 2020, des factions internes se sont divisées entre les militants de la gauche libérale (qui privilégiaient le genre, le climat et le soutien à l’Ukraine) et les matérialistes de classe de Wagenknecht (exigeant la justice économique et la paix avec la Russie). Lorsque Die Linke a soutenu une aide militaire illimitée à l’Ukraine, Wagenknecht a remarqué que Die Linke était devenu un parti de guerre et non de solidarité. Son départ pour former BSW en 2024 a couronné des décennies de désillusion.
Pourquoi BSW ?
BSW s’engage à recentrer la gauche sur les préoccupations matérielles : l’augmentation des inégalités, la désindustrialisation et l’arrêt de la militarisation de la « Zeitenwende » en Allemagne. Son programme mélange des politiques d’État-providence de la vieille école (nationalisation des industries clés, imposition des riches) avec un scepticisme populiste à l’égard de l’OTAN, de l’aide à l’Ukraine et de la migration de masse.Le paradoxe de BSW
Le pari de BSW est que la justice économique peut l’emporter sur les divisions culturelles. Pourtant, sa position sur l’immigration et son refus de « choisir son camp » dans la guerre en Ukraine lui ont valu des accusations de flirt avec les discours de droite. Même si la BSW est résolument pro-paix. Peut-il unir les électeurs désabusés du SPD et les partisans mécontents de l’AfD – ou va-t-il fracturer davantage la gauche ?
La métamorphose de l’AfD – Du néolibéralisme au nationalisme
Un parti né de l’austérité
L’AfD a vu le jour en 2013 pour protester contre les renflouements de la zone euro, attirant des universitaires fiscalement conservateurs et des transfuges de la CDU. Mais la crise des réfugiés de 2015 a accéléré son virage vers l’ethno-nationalisme, le transformant en un véhicule de rage anti-immigrés, de ressentiment anti-élite et de nostalgie d’un passé allemand mythique.Le playbook de l’AfD
Grief culturel : Présenter l’immigration comme une menace existentielle pour « l’identité allemande ».
Tour de passe-passe économique : Promouvoir des politiques néolibérales (déréglementation, baisses d’impôts) tout en se posant en champion du « petit homme ».
Populisme anti-système : Se positionner comme le seul défenseur de la liberté d’expression contre la censure « woke ».
Comme l’a
averti Émile Durkheim, les changements sociaux rapides engendrent la désorientation et l’extrémisme. L’AfD prospère dans « l’anomie » de l’Allemagne après la réunification, où la désindustrialisation, la stagnation des salaires et la dislocation culturelle ont érodé la confiance dans les institutions. Sa base n’est pas seulement celle des désespérés économiques, mais aussi de ceux qui craignent le déclin – un puissant mélange d’insécurité et de ressentiment.L’AfD et l’OTAN : des loups déguisés
en moutons Bien qu’elle se présente comme une « guerre anti-Ukraine », l’AfD n’est pas pacifiste. Tout en critiquant l’aide militaire de l’Allemagne à l’Ukraine et en appelant au dialogue avec la Russie, le parti soutient explicitement l’OTAN et préconise même d’augmenter le budget militaire de l’Allemagne à 5 %. Son programme de 2023 promet de « renforcer l’OTAN en tant qu’alliance défensive » tout en s’opposant à l’intégration de la défense de l’UE – une tournure nationaliste et non une position anti-impérialiste.
Choc des contrepoids – BSW vs. AfD
Deux crises, deux visions BSW
et l’AfD canalisent tous deux la colère des électeurs contre l’establishment politique allemand, mais leurs programmes ne pourraient pas être plus opposés. L’un cherche à ressusciter la solidarité de classe ; l’autre, le nationalisme ethnique. Ci-dessous, une ventilation de leurs différences marquées :
Le parti
de Wagenknecht présente l’inégalité comme systémique – un produit du capitalisme néolibéral et de la cupidité des entreprises. Ses solutions sont résolument sociales : taxer les riches, renationaliser les industries privatisées et reconstruire l’État-providence. La position anti-OTAN de BSW, enracinée dans le pacifisme de l’époque de la guerre froide, vise à séduire les électeurs fatigués de la « Zeitenwende » militarisée de l’Allemagne.L’AfD
se pose en défenseur des « Allemands ordinaires » mais promeut des politiques qui aggraveraient les inégalités. Sa rhétorique de « l’Allemagne d’abord » masque un programme hyper-capitaliste : réduction des impôts pour les riches, éviscération de la protection des travailleurs et privatisation des services publics. Bien qu’elle prétende s’opposer à la guerre, l’AfD soutient fermement l’OTAN (la qualifiant d'« essentielle à la sécurité allemande ») tout en essayant d’arrêter le financement de l’Ukraine – une contradiction qui révèle son opportunisme et non son pacifisme.Un terrain partagé ?
Les deux partis exploitent la méfiance à l’égard des médias et des élites, mais leurs bases électorales divergent :
BSW : Cible les travailleurs est-allemands, les électeurs désabusés du SPD et les gauchistes anti-guerre.
AfD : S’adresse aux propriétaires de petites entreprises, aux conservateurs convaincus et à ceux qui ont des sentiments anti-immigrants.
L’ironie ? Alors que les électeurs de BSW et de l’AfD se sentent tous deux « laissés pour compte », leurs mouvements s’excluent mutuellement – l’un accuse le capitalisme, l’autre fait des migrants des boucs émissaires.
Pourquoi ce fossé est important
Le réalignement politique de l’Allemagne n’est pas seulement une question de gauche contre droite, c’est une bataille sur ce qui constitue la justice. BSW soutient que la pauvreté découle de l’exploitation ; l’AfD prétend que c’est causé par des « étrangers » qui drainent les ressources. La CDU, quant à elle, offre un néolibéralisme réchauffé avec une garniture xénophobe.
Comme Bertolt Brecht l’a mis en garde dans L’Opéra de quat’sous :
« La nourriture est la première chose. La morale suit.
La maxime de Brecht va au cœur de la crise allemande : lorsque les besoins matériels ne sont pas satisfaits, la moralité se fracture. BSW et AfD représentent deux voies pour sortir de cette rupture : la solidarité ou la désignation de boucs émissaires. La question est de savoir quelle vision les électeurs vont supporter.
Le virage à droite de la CDU : à la poursuite de l’AfD
Du centre de Merkel aux guerres
culturelles de Merz La CDU, autrefois le parti naturel du gouvernement allemand, est en crise. Après le règne centriste d’Angela Merkel, le nouveau dirigeant Friedrich Merz a viré à droite pour reconquérir les électeurs qui flirtent avec l’AfD. La stratégie ? Imiter les points de discussion de l’AfD :
Rhétorique anti-immigrés : Merz met en garde contre les « sociétés parallèles » et exige des expulsions plus rapides et la fin de la double citoyenneté.
Welfare Bashing : Qualifier les allocations de chômage d'« invitation à l’oisiveté ».
Contrecoup climatique : Qualifier les politiques énergétiques des Verts de « suicide économique ».
Un jeu
dangereux Le virage de la CDU risque de normaliser les discours d’extrême droite. En se faisant l’écho des slogans de l’AfD, Merz légitime la xénophobie sans proposer de solutions aux inégalités. Les sondages suggèrent que la tactique fonctionne – la CDU est en tête à l’échelle nationale avec 30 % – mais à quel prix ?Comme l’a écrit Bertolt Brecht dans La Solution pendant le soulèvement est-allemand de 1953 :
« Ne serait-il pas plus facile / Dans ce cas pour le gouvernement / De dissoudre le peuple / Et d’en élire un autre ? »
La question sardonique de Brecht reflète l’énigme de l’establishment d’aujourd’hui : plutôt que de répondre au désespoir des électeurs ; la CDU cherche à « dissoudre » la dissidence en devenant l’AfD-lite.
L’ombre de Weimar : l’Allemagne peut-elle éviter l’effondrement démocratique ?
Des échos des années 1930 ?
L’Allemagne n’est pas encore Weimar. Mais les parallèles sont troublants : les inégalités économiques aux niveaux d’avant la Seconde Guerre mondiale, les institutions qui luttent pour contenir l’extrémisme et une élite apparemment centriste discréditée par l’austérité et la guerre. La normalisation de l’AfD (qui s’élève maintenant à 20 %) et le virage à droite de la CDU suggèrent que la démocratie s’érode de l’intérieur.Le sociologue Émile Durkheim
a soutenu que la cohésion sociale nécessite des valeurs partagées et des filets de sécurité solides. Pour l’Allemagne, cela signifie :
Renouvellement économique : Investir dans le logement, les soins de santé et la réindustrialisation pour restaurer la confiance dans les processus démocratiques.
Réalisme migratoire : Pour apaiser les tensions culturelles, associez l’asile humanitaire à des programmes d’intégration. Créer une politique régionale de migration et d’asile qui soit correctement mise en œuvre.
Réinvention démocratique : Donner aux syndicats et aux conseils locaux les moyens de combler le fossé entre les élites et les citoyens.
Conclusion : Combler le fossé
L’Allemagne se trouve à la croisée des chemins. L’AfD propose des boucs émissaires et de la nostalgie ; BSW, un rêve de solidarité qui s’évanouit. Le SPD et la CDU, quant à eux, s’accrochent à un statu quo brisé.
Pourtant, l’histoire offre de l’espoir. L’Allemagne d’après-guerre s’est reconstruite grâce à la social-démocratie et à l’inclusion. Les crises d’aujourd’hui exigent une ambition similaire – non pas un pragmatisme creux, mais une politique qui marie la justice économique et l’appartenance culturelle. L’alternative est impensable : une nation fracturée, toujours au bord du gouffre.

Ressources recommandées
Pour les lecteurs désireux de plonger plus profondément dans les bouleversements politiques de l’Allemagne, le néolibéralisme et l’affrontement entre populisme de gauche et de droite :
Livres
Philip Manow, L’économie politique du populisme (2023)
Explore comment les inégalités économiques alimentent les mouvements populistes, avec des études de cas sur l’AfD en Allemagne et Die Linke.
Wolfgang Streeck, Comment le capitalisme va-t-il s’arrêter ? (2016)
Une critique marxiste de l’érosion de la démocratie par le néolibéralisme, essentielle pour comprendre le déclin du SPD.
Sheri Berman, Démocratie et dictature en Europe (2019)
Retrace la stabilité démocratique de l’Allemagne d’après-guerre et sa fragilité actuelle à travers un prisme historique.
Jan-Werner Müller, Qu’est-ce que le populisme ? (2016)
Une introduction concise sur les mécanismes du populisme, utile pour disséquer la rhétorique de BSW et de l’AfD.
Vidéos
Garland Nixon - L’ESPRIT ET LA SAGESSE DE MARK SLEBODA EP 8 - L’UE SE DÉCOLLE - UKRAINE FRONTLINES (2025)
Bien qu’il ne s’agisse pas explicitement de l’Allemagne, cet épisode de YouTube aborde la politique européenne et son clivage gauche-droite dans un contexte géopolitique.
Die WELTWOCHE - « Der Krieg ist für die Ukraine verloren » : Weltwoche-Gespräch mit Viktor Orbán und Gerhard Schröder (2024)
Malheureusement, c’est en langue allemande, mais cela reflète la néolibéralisation du SPD
Le Duran - L’Allemagne désindustrialisée et subordonnée - Sevim Dağdelen, Alexander Mercouris et Glenn Diesen (2025)
Discussion passionnante avec un membre de la BSW sur sa position en matière de politique étrangère.
Note finale
Ces ressources offrent des perspectives pour disséquer la crise de l’Allemagne – de l’économie néolibérale à la décadence morale contre laquelle Brecht a mis en garde. Pour ceux qui manquent de temps, commencez par les œuvres de Philip Manow.
Faites-moi savoir si vous souhaitez des liens ou des suggestions supplémentaires !
Prise en charge de l’analyse indépendante
Si vous avez trouvé cette plongée profonde dans la crise politique de l’Allemagne utile, envisagez de soutenir mon travail :
Abonnez-vous à ce Substack pour une analyse plus longue de la politique européenne et du populisme.
Mise à niveau vers la version payante
Partagez cet article avec des amis, des collègues ou les médias sociaux – le débat prospère lorsque les idées circulent.
Les démocraties s’effilochent lorsque l’examen s’estompe. En vous abonnant ou en partageant, vous c