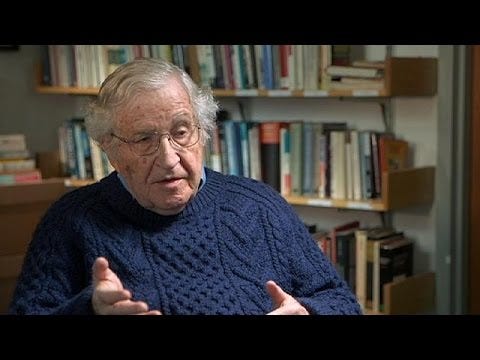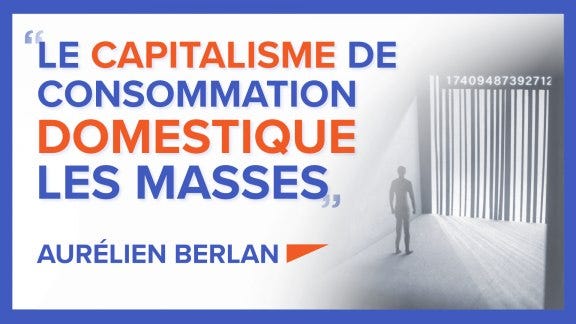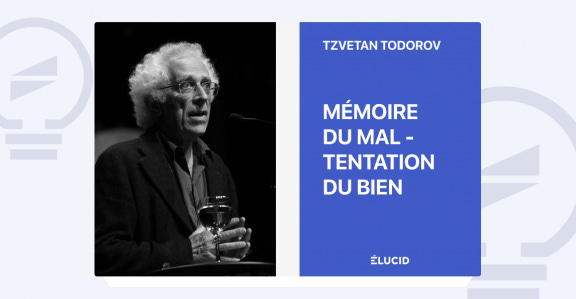La Fabrique du consentement - Noam Chomsky
Présentation du livre rédigé par Noam Chomsky par les équipes d'ELUCID le 11 aout 2023
Dans La fabrique du consentement (1989), Noam Chomsky s’intéresse à un modèle de propagande spécifique, celui des médias. Le fonctionnement des médias est décrit comme celui d’une industrie au service de l’État et des grands groupes industriels, le tout dans une économie de marché.
L’ouvrage nous montre comment les médias de masse, loin d’informer le lecteur, soutiennent des intérêts particuliers. Les puissants de ce monde disposent du pouvoir de choisir ce que le peuple pourra voir, entendre ou même penser. Selon Chomsky, ces procédés s’inscrivent dans un véritable système de propagande, dont l’objectif est de gérer l’opinion publique et ainsi de pérenniser cette organisation.
Ce qu’il faut retenir :
Notre système est fondé sur un modèle de propagande, dont les médias sont un outil essentiel. Ce modèle s’est renforcé dans les années 1970-1980, avec l’ouverture du monde médiatique aux investissements privés. Il existe dorénavant d’étroites relations entre l’industrie médiatique et les élites au pouvoir. C’est une culture de consommation dépolitisée qui est alors promue.
Cette propagande permet de créer l’adhésion des masses aux décisions politiques et géopolitiques des élites, notamment en faisant intervenir des “experts” qui légitiment leurs intérêts. La désinformation pure et simple remplace parfois l’information, notamment lorsqu’il s’agit de défendre la diplomatie américaine.
Biographie de l’auteur
Noam Chomsky, né en 1928 à Philadelphie, est un linguiste américain et professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology où il a enseigné durant l’intégralité de sa carrière.
Également connu pour son activisme politique et sa critique de la politique étrangère et des médias américains, il s’affiche comme un sympathisant de l’anarcho-syndicalisme. Entre autres, il fustige l’utilisation du terme « terroriste » qui, selon lui, permet aux gouvernements de se dédouaner de la dimension terroriste de leurs propres politiques. Il est également un fervent défenseur de la liberté d’expression.
Très apprécié par l’extrême gauche, Noam Chomsky est soumis à de vives critiques de la part des libéraux et des partisans de la droite américaine. Il reste pourtant reconnu comme l’un des plus grands intellectuels vivants, ayant notamment reçu de nombreux diplômes honorifiques des plus grandes universités au monde.
Avertissement : Ce document est une synthèse de l’ouvrage de référence susvisé, réalisé par les équipes d’Élucid ; il a vocation à retranscrire les grandes idées de cet ouvrage et n’a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l’ouvrage de référence chez votre libraire. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l’ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur.
Plan de l’ouvrage
Préface
Introduction
Un modèle de propagande
Synthèse de l’ouvrage
NB : Cette synthèse se concentre essentiellement sur le premier chapitre de La fabrique du consentement qui présente les ressorts théoriques de l’ouvrage, tandis que les chapitres suivants ne sont que des exemples des considérations théoriques en question.
Préface
« Naturellement le propagandiste ne peut révéler les intentions réelles de l’autorité pour laquelle il agit […] Cela reviendrait à livrer ses projets au débat public, aux clés de l’opinion publique, ce qui leur ôterait toute chance de succès […] La propagande doit au contraire couvrir ces projets comme un voile, masquant l’intention véritable. »
Jacques Ellul, Propaganda, New York, Knopf, 1965, p. 58-59 (tel que cité par Noam Chomsky)
Introduction
Notre système repose sur un modèle de propagande. Par divers moyens, les médias structurent le système d’information afin de corroborer une certaine vision du monde, la faisant passer pour objective. Le principal procédé mis en œuvre par les médias est le recours à « la parole des spécialistes ».
Ces spécialistes ou experts sont présentés comme les personnes les plus qualifiées pour discuter de certains sujets. De cette manière, leur opinion ne peut être contestée. Ces personnes sont triées sur le volet afin de ne laisser aucune forme de dissidence se développer. « Toute la beauté du système consiste à ne jamais laisser cette dissidence ou ce genre d’informations passer certaines limites ou cesser d’être marginales. »
Les années 1970-1980 constituent le tournant et l’avènement d’un système médiatique globalisé. L’idéologie néolibérale mondialisée a entraîné l’ouverture de l’industrie audiovisuelle aux investissements privés. Cela a eu des répercussions immédiates sur les systèmes médiatiques, avec notamment l’apparition de publicité, la modernisation des moyens de communication et de contrôle des pensées.
Quelques années plus tard, Internet est venu à nouveau modifier le fonctionnement médiatique. Si son apparition a fourni un formidable moyen de communication aux dissidents, cet outil a été rapidement accaparé par les médias de masse. Redoutant la trop grande liberté qu’Internet représentait, l’industrie de la presse l’a rapidement appréhendé.
Selon Max Frankel, ex-éditeur du New York Times, « plus les journaux viseront les Internautes, plus on verra de sexe, de sports, de violence et de comédies à leurs menus, reléguant ou passant directement à la trappe les infos concernant les conflits étrangers ou les réformes du système de protections sociales. » L’avènement de l’ère du divertissement prend la place de la culture et de la connaissance comme moyens pour l’être humain de grandir et de penser.
Ces changements de nature dans le traitement de l’information ont entraîné un renforcement du modèle de propagande, qui promeut une culture de consommation dépolitisée. Le ciblage publicitaire et informationnel en résultant a ébranlé l’organisation démocratique. En effet, l’attention des citoyens est détournée de la sphère publique au profit d’un système d’achat et de vente de biens de consommation.
En d’autres termes, le public n’est plus souverain lorsqu’il s’agit des médias. Ces derniers, usant d’un système publicitaire efficace, peuvent conditionner la façon d’agir de la population, cela parce que « les gens ne lisent et ne regardent généralement que ce qui est directement accessible ou fait l’objet d’une promotion intensive ».
Les médias de masse exercent également une influence sur la diplomatie américaine. En occultant les victimes que produisent les interventions américaines ou en les présentant comme une menace pour le pays, les médias permettent à l’armée américaine de mener leurs opérations de répression sans craindre un bashing de la part de l’opinion publique.
Pourtant, certains médias alternatifs avec des budgets moindres parviennent à prouver l’implication de l’armée américaine dans des massacres à l’étranger. La question prépondérante est celle de la transparence de cette presse grand public. « Seuls des facteurs politiques peuvent expliquer les différences qualitatives du traitement médiatique des victimes » entre ces petits médias alternatifs et les grands médias.
Dans la même veine, les médias américains s’abstiennent de condamner les actes de barbarie commis par des pays soutenus économiquement et diplomatiquement par le Président en mandat. Cela a été le cas pour la Turquie ou l’Indonésie. Les médias ont passé sous silence les massacres qui ont lieu dans ces pays contre des minorités, sans jamais évoquer le terme de génocide.
Également, les médias de masse ont légitimé des scrutins sans valeur comme au Salvador — pays client des États-Unis — tout en refusant de reconnaître le résultat des élections au Nicaragua — pays avec lequel les États-Unis sont en conflit. La même chose peut être constatée s’agissant du Vietnam. « Depuis cette période, nous n’avons jamais trouvé un seul éditorial qui définisse la guerre des États-Unis contre le Vietnam, puis contre toute l’Indochine, comme un cas d’agression caractérisée ». Nous sommes face à un système de média « à deux vitesses ».
En somme, « Le modèle de propagande reste donc un outil d’analyse parfaitement efficace pour expliquer les mécanismes de notre industrie médiatique ». C’est cette propagande qui influence l’orientation prise par les médias et pérennise l’existence de ce système.
I. Un modèle de propagande
Il est difficile d’observer les mécanismes de propagande au sein des médias de masse. En effet, dans les pays où ces médias sont des entreprises privées, critiquer leur fonctionnement alors qu’ils tendent à se positionner en défenseur de la liberté d’expression est une tâche délicate et difficile. Ce barrage à la critique conduit à l’avènement d’un « empire des élites sur les médias et une marginalisation des dissidents ».
De surcroît, le poids du système pèse également sur les travailleurs dans ce domaine. En effet, ces élites journalistiques tendent à s’autoconvaincre qu’ils traitent les informations de façon objective.
Les secteurs de l’industrie médiatique et le monde des affaires sont extrêmement liés. « Près des deux tiers des dirigeants de médias qui n’ont pas fait leur carrière dans ce secteur viennent du monde des affaires ».
En outre, les médias sont tous commercialement liés à de grands fonds d’investissement ou autres banques. En conséquence, progressivement intégrés aux marchés boursiers, ils donnent une place prépondérante à la quête de rentabilité dans leur activité et cherchent à se rendre attractifs pour favoriser les investissements.
Dès lors, on bascule dans une nouvelle ère pour les médias, l’ère des non-restrictions, de la publicité, de la commercialisation de l’information. « En somme, les groupes multimédias dominants sont réellement des entreprises colossales, dirigées par des milliardaires ou des PDG étroitement contrôlés par les propriétaires d’autres groupes d’intérêts purement lucratifs. »
Les mastodontes médiatiques ont donc pris le parti de s’orienter sur différents supports pour diffuser leur information. Évidemment, le passage de l’information à la télévision a fait office de tournant dans l’histoire de l’industrie médiatique. « Seule une petite minorité des vingt-quatre plus grands géants médiatiques s’en tient à un unique secteur ».
De même, il y a des relations évidentes entre les groupes médiatiques et les gouvernements. « Toute entreprise audiovisuelle est soumise à un système de franchises et de licences gouvernementales qui la laisse à la merci des contrôles, voire du harcèlement du gouvernement ». Il existe ainsi de nombreux accords tacites qui sous-tendent une relation privilégiée entre les médias et les politiques. Cela permet d’expliquer pourquoi nos informations sont orientées et sélectives.
Par ailleurs, avec l’avènement de la publicité comme moyen de rémunérer les médias, il est évident que ces mêmes médias ne s’autofinancent plus par la vente de leur contenu, mais par les paiements des annonceurs. Ainsi, ce sont « les préférences des annonceurs qui déterminent la prospérité, voire la survie d’un média ». Cela a eu pour conséquence une marginalisation certaine, voire la disparition des journaux ouvriers dont les lecteurs étaient d’origine modeste et n’avaient ainsi pas grand intérêt aux yeux des annonceurs. La dimension politique des médias s’amincit alors, jusqu’à devenir très superficielle.
Les médias de masse attirent désormais leurs lecteurs non plus pour les informer, les instruire, mais « en fonction de [leur] pouvoir d’achat ». Les annonceurs cherchent évidemment à toucher les publics les plus aisés afin d’être les plus rentables possibles. Pour résumer, « les mass medias sont d’autant plus démocratiques qu’ils s’adressent à un public très large est d’autant moins crédible que son pendant politique est un système électoral où l’on pèse selon ses revenus ! ». Les publicitaires ont la capacité d’imposer, ou tout du moins d’orienter les programmations des médias puisque ce sont eux qui les achètent et les financent.
Le choix des sources est également primordial pour ces médias. Ils entretiennent des liens étroits avec de puissantes sources d’information, car ils ont besoin d’un flux ininterrompu d’informations brutes qu’ils pourront ensuite soumettre à leur auditoire.
À cela s’ajoute un fort lobbying de la part de nombreuses organisations et autres chambres de commerce régionales ou même nationales.
Ces différents soutiens n’apportent pas seulement des sources et des fonds, mais produisent également « des experts » dont l’objectif est d’appuyer et de défendre l’opinion partagée par ces médias et autorités privées à qui ils sont liés. Cela permet, en contrepartie, à ces experts de financer leurs recherches, d’être relayés à plus grande échelle. Pour illustrer ce point, les paroles du juge Lewis Powell trouvent un parfait écho, « il faut acheter les universitaires les plus réputés du pays afin de crédibiliser les études des industriels et de leur donner davantage de poids sur les campus universitaires ».
La flak est quant à elle un autre moyen de pression sur les médias. Plus qu’une simple « critique » (ndlr : son sens littéral), elle se définit comme l’ensemble des réactions négatives aux positions des médias. Elle prend différentes formes : des pétitions, des discours ou encore des poursuites judiciaires. Lorsque cette flak est réellement menaçante, elle constitue l’apanage du pouvoir pour se défendre face aux critiques des médias sur les milieux des affaires.
« Pour autant, bien que les mass medias soient presque constamment sous le feu de ces flak machines, ils les traitent toujours convenablement, font preuve à leur égard d’une attention respectueuse. ». Avec cette flak, le gouvernement et les différents organes politiques disposent d’une assise sur ces médias leur permettant d’accroître leur suprématie. C’est bel et bien d’un contrôle de l’information dont il est question — un contrôle discret, mais efficace.
La notion d’anticommunisme est elle aussi utilisée comme mécanisme de contrôle. « Cette idéologie permet de mobiliser le peuple contre un ennemi ». Le concept d’anticommunisme reste ainsi assez flou pour permettre aux instances gouvernementales d’utiliser cet argument contre quiconque ne sera pas intransigeant face au communisme.
Dans le même temps, « soutenir le fascisme un peu partout dans le monde se justifie finalement comme un moindre mal ». Cet anticommunisme a beaucoup d’influence sur les mass medias : « tous les sujets tendent à se réduire à une représentation manichéenne du monde : communistes d’un côté, anticommunistes de l’autre […]. Promouvoir notre camp apparaît dès lors comme la plus légitime des pratiques en matière d’information ».
L’accumulation de ces filtres d’informations conduit à une dichotomisation systématique du traitement des sujets. Si l’on prend l’exemple de la diplomatie, « le résultat est le même que si un commissaire avait donné pour consigne aux médias : “Concentrez-vous sur les victimes de nos adversaires et laissez tomber celles de nos alliés” ».
En ce qui concerne les campagnes de propagande, elles sont toujours parfaitement alignées sur les intérêts des élites. Elles sont généralement lancées directement par le gouvernement ou alors par des firmes de l’industrie médiatique. L’objectif étant de discréditer un adversaire, un organisme tiers auquel l’intérêt américain s’oppose.
« En définitive, une couverture médiatique à visée propagandiste se traduira logiquement par une dichotomisation de la présentation des nouvelles, en fonction de ce qui sert les objectifs de puissants intérêts nationaux. »
*
Vous avez aimé cette synthèse ? Vous adorerez l’ouvrage ! Achetez-le chez un libraire !
Propagande Médias sous influence Bibliothèque Monde Amérique