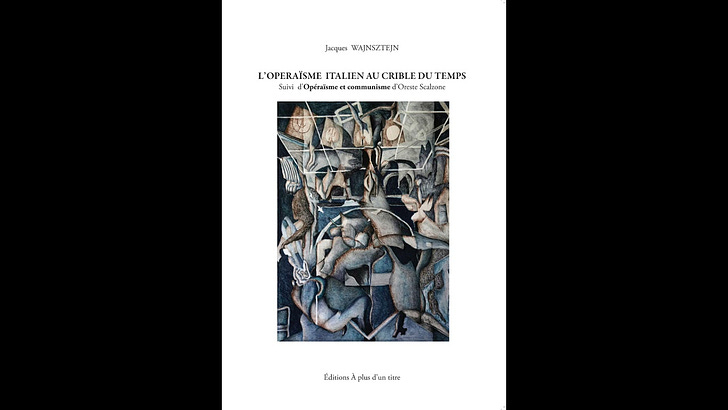Aux origines d’une sociologie critique du travail : opéraïsme et enquête militante en Italie (années 1950-1960)
Ferruccio Ricciardi Dans Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine (2019), pages 125 à 137
Dans Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine (2019), pages 125 à 137
Chapitre
Le renouveau de l’enquête ouvrière en Italie après la Seconde Guerre mondiale doit beaucoup à la mouvance intellectuelle et politique opéraïste, un courant marxiste hétérodoxe, antiautoritaire et hostile aux porte-parole traditionnels (syndicats et partis), qui voit dans la massification de la classe ouvrière l’occasion de transformer, dans un sens révolutionnaire, la société capitaliste et les logiques qui président à son expansion [Tronti, 2013]. Au carrefour du militantisme politique et de l’activité de recherche, l’opéraïsme s’empresse, au tournant des années 1960, de déchiffrer les transformations en cours (industrialisation précoce, urbanisation, rationalisation du travail, émergence du consumérisme, etc.) tout en essayant de jeter les bases d’une nouvelle action politique fondée sur l’analyse scientifique de la condition ouvrière. L’enquête représente l’instrument phare au service de l’opéraïsme italien dans sa première phase, animée par des intellectuels et militants dont la plupart se réunissent autour de la revue Quaderni rossi (1961-1966).
Aujourd’hui, l’opéraïsme fait l’objet de nombreuses études qui s’appuient souvent sur les témoignages des protagonistes de l’époque [Borio et al., 2002 et 2005 ; Trotta et Milana, 2009]. On assiste à la tentative de légitimation d’un courant très influent mais minoritaire au sein de la « nouvelle gauche » italienne, en sanctionnant son passage du champ politique au champ intellectuel à proprement parler. Il s’agit d’une opération à la fois historiographique et mémorielle qui tend à dessiner un parcours linéaire et cohérent de cette expérience militante, des années 1950 jusqu’à nos jours, alors que le terme opéraïsme n’est même pas utilisé avant la seconde moitié des années 1970 [Scavino, 2017]. Dans cette perspective, la composante scientifique est minorée. Le témoignage de Mario Tronti, figure de proue de l’opéraïsme, est à cet égard parlant :
Lorsqu’on parle des Quaderni rossi […], on pense à un groupe d’intellectuels qui fait une intervention dans les luttes ouvrières. Les Quaderni rossi ont été cela. Personne ne pense aux Quaderni rossi comme à une entreprise d’analyse sociologique des conditions de l’usine moderne.
[Trotta et Milana, 2009, p. 609].
En prenant à rebours l’interprétation partisane, cet article entend explorer la nature, l’usage et la réception de l’enquête ouvrière dans son acception éminemment sociologique au sein du courant opéraïste. En remontant aux initiatives pionnières en matière d’enquête ouvrière, expérimentées au lendemain de la guerre, il s’agit ici d’esquisser l’histoire sociale d’une entreprise intellectuelle novatrice. Celle-ci a eu le mérite d’ouvrir la voie en Italie à une première forme de sociologie critique du travail, en mettant l’accent sur des thèmes inédits (la subjectivité de la condition ouvrière, la phénoménologie de la vie au travail, la conflictualité, etc.) ainsi que sur des méthodologies partiellement délaissées par la sociologie académique : l’enquête ethnographique et, plus largement, la construction qualitative du terrain.
Société et sociologie dans les années du « miracle économique »
Pour comprendre cet intérêt renouvelé à l’égard de l’enquête, on ne peut pas faire abstraction de profondes mutations sociales qui interviennent en Italie durant les années dudit « miracle économique » (de la moitié des années 1950 au début des années 1960), c’est-à-dire une période de croissance économique sans précédent qui s’accompagne aussi d’une modernisation industrielle aux effets contrastés notamment pour les classes populaires [Crainz, 1996].
Le besoin de comprendre les transformations sociales de l’époque trouve une réponse dans la « redécouverte » de la sociologie, discipline qui est de moins en moins qualifiée de « bourgeoise » par les intellectuels marxistes, et qui rencontre la faveur de nombreux étudiants après sa mise à l’écart durant le fascisme [Beccalli, 2007]. En outre, les outils de la sociologie sont à même d’interroger les mutations qui ont affecté le monde du travail industriel (la rationalisation taylorienne) et, plus particulièrement, le rapport entre les travailleurs et les organisations syndicales, rapport qui vit alors une phase de crise aiguë. Le débat sur les liens entre progrès technique et action syndicale entamé en 1955 par la principale centrale syndicale, la CGIL, conduit à un constat partagé : l’action syndicale a longtemps oublié l’usine et ses enjeux, alors que pour relancer l’activité de mobilisation et de revendication il faut partir des problèmes qui touchent les ouvriers au quotidien. Cela suppose également de combler un déficit de connaissances des systèmes de production et de leurs conséquences sur les conditions de vie et de travail des salariés. D’où l’effort entrepris vers l’étude du monde industriel à partir d’une réflexion commune aux syndicalistes, aux sociologues et à d’autres chercheurs en sciences sociales, dont témoignent deux importants colloques sur le « progrès technique » organisés respectivement par l’Institut Gramsci de Rome en 1956 et le Centre national de préventions et défense sociale de Milan en 1962 [Istituto Gramsci, 1956 ; Momigliano, 1962].
C’est dans ce contexte de crise de la représentation syndicale face à un monde industriel en pleine transformation, qu’émerge le projet de la revue Quaderni rossi. L’impulsion provient de syndicalistes et d’intellectuels appartenant à l’aile gauche du Parti socialiste italien, alors très actif dans l’animation du débat intellectuel d’inspiration marxiste [Scotti, 2011]. Il s’agit d’interroger les contradictions que le progrès technique et, plus généralement, la dynamique du capitalisme industriel entraînent dans le mouvement ouvrier (ce qu’à l’époque on qualifie de néocapitalisme) [Trentin, 1962].
Paris, Detroit et… Crémone : Danilo Montaldi et la conricerca
Durant les années 1950, le recours à l’enquête se diffuse au sein des milieux intellectuels et militants de la « nouvelle gauche » italienne. Ils souhaitent investiguer sur ces « marginaux » qui, bon gré mal gré, peuplent une société en voie de rapide « modernisation » : Ernesto de Martino s’intéresse à l’ethnographie de la société paysanne du sud de l’Italie, Danilo Dolci étudie les sous-prolétaires siciliens, Danilo Montaldi mène ses premières enquêtes sur les paysans de la province de Crémone en Lombardie… Ce dernier (1929-1975), jeune militant du Parti communiste internationaliste et sociologue autodidacte, se fait le promoteur d’une pratique d’investigation qui est tributaire d’une réflexion transnationale sur la condition ouvrière. En 1954, à l’occasion d’un bref séjour à Paris, il entre en contacte avec le groupe Socialisme ou Barbarie, avec qui il noue des rapports aussi bien de collaboration que d’amitié (comme en témoignent les visites de Claude Lefort chez Montaldi, à Crémone, en 1964, 1973 et 1974) [Fiameni, 2006]. Ces premiers échanges débouchent sur la traduction du texte de Paul Romano, The American Worker, à partir de la traduction française publiée en 1949 dans la revue fondée par Castoriadis et Lefort. Ouvrier chez General Motors, membre du groupe d’activistes et intellectuels d’inspiration trotskiste Johnson-Forest Tendency réunis à Detroit autour de la revue Correspondence, Romano signe un pamphlet dénonçant les conditions d’exploitation des ouvriers ainsi que les méthodes bureaucratiques employées par les syndicats. Ces derniers contribuent en effet à étouffer les revendications des travailleurs et leur potentiel conflictuel, notamment ces « forces nouvelles » (travailleurs jeunes, immigrés et/ou racialisés) qui ont du mal à accepter les traditionnels mots d’ordre de la régulation salariale et de la négociation collective [Pizzolato, 2013]. Ce texte, d’après Montaldi exprime
l’idée, pratiquement délaissée par le mouvement marxiste depuis la publication du premier volume du Capital, que l’ouvrier est avant tout un être qui vit dans la production et dans l’usine capitaliste avant d’être inscrit à un parti, avant d’être un militant de la révolution ou un sujet d’un futur pouvoir socialiste : et c’est dans la production que se forgent aussi bien sa rébellion contre l’exploitation que sa capacité à construire une typologie supérieure de société, sa solidarité de classe avec les autres salariés et sa haine à l’égard de l’exploitation et de ceux qui l’exercent, que ce soient les patrons classiques d’hier ou les bureaucrates impersonnels d’aujourd’hui et de demain [1].
L’esprit de Romano trouve un écho dans les pages du Journal d’un ouvrier de Daniel Mothé, publié en 1959 sous l’égide du groupe Socialisme ou Barbarie, et dont Montaldi assure peu après la traduction en italien pour les éditions Einaudi. Ce texte porte sur l’analyse des effets négatifs produits par la rationalisation du travail et l’action de « collaboration » des organisations syndicales, et exprime le désarroi consécutif des salariés : « L’ouvrier – synthétise de manière un peu crue Montaldi – pour le patronat n’est rien d’autre qu’une machine, alors que pour le syndicat, c’est le tube digestif. » D’un point de vue méthodologique, le livre offre également des pistes à creuser, car
la réalité n’est pas interprétée de haut en bas, à l’aide de structures conceptuelles préétablies ; en accord avec l’activité pratique développée par l’auteur (cette reconversion militante de la théorie à la pratique), le texte se déroule et permet de passer de la participation au quotidien à l’élaboration idéologique [2].
Le pari est donc double : faire du marxisme un instrument de connaissance sociologique et contribuer au renouveau des pratiques d’enquête sociale. En tirant profit des expériences développées des deux côtés de l’Atlantique, Montaldi s’empresse de mettre en valeur l’étude du quotidien des classes subalternes en bousculant la vision officielle offerte par les porte-parole institutionnels. L’essai « L’Expérience prolétarienne » de Claude Lefort influence ses premières enquêtes centrées sur les milieux agricoles à Crémone en 1956. Si la « classe », d’après Lefort, ne peut être connue que par elle-même, alors il faut lui donner la parole tout en essayant de restituer « de l’intérieur » son comportement mais aussi sa capacité d’invention et son pouvoir d’organisation sociale [Lefort, 1952]. À partir de ce constat, Montaldi vient à formuler une hypothèse de recherche novatrice, qui sera par la suite qualifiée de conricerca (recherche en commun) : le chercheur et celui/celle qui fait l’objet de la recherche participent au même projet politique, dans la mesure où il y a convergence d’intérêts et d’attentes entre les deux sujets [Salvati, 2007].
On retrouve les prémisses de cette approche dans l’enquête ethnographique réalisée à Crémone au début des années 1950 portant sur une « cellule de base » du Parti communiste italien, composée d’ouvriers, paysans et chômeurs [Montaldi, 1994]. En suivant de près l’action et les intentions des militants, Montaldi met en exergue les multiples lignes de tension entre le « privé » (le quotidien des travailleurs et militants) et le « public » (les représentations véhiculées par le parti). Le choix de faire la révolution (contre l’avis du parti) est évoqué par les militants de base avec l’expression sotto voce (à voix basse), du nom du grappino, une eau-de-vie qu’on consomme le matin alors que sa vente est interdite. De même les militants réunis dans un groupe externe à la cellule n’hésitent pas à discuter des orientations idéologiques incarnées par Staline et Trotsky, au mépris des consignes du parti interdisant un tel débat. Enfin les journaliers et salariés agricoles s’opposant aux privilèges de certaines catégories de travailleurs (les trayeurs, les chefs d’étables, les conducteurs de tracteurs, etc.), donnent lieu soit à des réactions de désinvolture soit à de rébellions violentes (incendies des fermes, inondations des champs, etc.), qui sont considérées par l’auteur comme des « actes politiques » à part entière [3].
L’intérêt à la fois politique et méthodologique à l’égard des récits de vie, ainsi que la confiance dans la capacité subversive de la parole des subalternes, émerge également à l’aune d’une analyse des écrits de Montaldi et de ses archives personnelles. La méthode autobiographique, par exemple, est au cœur d’une enquête saisissante sur le monde populaire aux marges de la légalité et des activités productives (braconniers, prostitués, petits voleurs, etc.) dans les campagnes autour du Pô [Montaldi, 1961]. Dans un registre proche, Montaldi (en collaboration avec Franco Alasia) interroge les espoirs et les frustrations des immigrés du sud de l’Italie qui s’installent dans la banlieue délabrée de Milan durant les années 1950, dans le cadre d’une enquête pionnière [Alasia, Montaldi, 1960]. D’autres bribes d’archives témoignent de cet engouement pour l’approche narrative : des entretiens de travailleurs émigrés en Allemagne, des témoignages en dialecte de paysans qui décrivent leurs conditions de travail, la transcription de la correspondance, datée de la fin xixe siècle, d’un jeune couple de paysans de Crémone destinés à se marier, etc. [4]. Raconter l’existence « nue » des « laissés-pour-compte » de la société industrielle devient la source principale du travail d’enquête.
« L’usage socialiste de l’enquête ouvrière » : Raniero Panzieri et les Quaderni rossi
La proposition méthodologique de Montaldi est au cœur des échanges entre Raniero Panzieri (1921-1964) et ses premiers collaborateurs lors de la réalisation d’une enquête sur les salariés de FIAT en 1961, moment préparatoire à la naissance des Quaderni rossi. Issu d’une famille modeste, installé en Sicile dans les années 1950, où il prend part aux luttes pour la redistribution des terres, Panzieri milite dans les rangs du Parti socialiste dont il devient membre du Comité central ainsi que directeur de la revue Mondo operaio. Exclu du parti en 1959 à cause de son opposition à l’accord de gouvernement avec la Démocratie chrétienne, il s’installe alors à Turin où il travaille pour la maison d’édition Einaudi. Comme responsable d’une collection de sciences sociales, il se lie à plusieurs groupes d’intellectuels, étudiants et syndicalistes fort critiques à l’égard de l’attitude des porte-parole traditionnels du mouvement ouvrier. C’est notamment grâce à la collaboration avec les syndicalistes turinois de la FIOM (la fédération de la métallurgie affiliée à la CGIL) que se concrétise le projet de la revue. Le premier numéro des Quaderni rossi, publié en 1961, tente ainsi de combiner l’analyse critique de la réalité industrielle avec l’expertise syndicale [Ferrero, 2005].
Dès le début, deux orientations majeures émergent au sein de la revue, l’une plus proprement « sociologique » et l’autre plus « interventionniste ». Selon la première tendance, l’expérience ouvrière devient matière à débat et à élaboration théorique pour les chercheurs, lesquels identifient par la suite les problématiques politiques à aborder. Selon la deuxième tendance, en revanche, l’objectif de l’enquête est d’alimenter le débat parmi les ouvriers et de leur fournir les instruments pour repérer les problèmes à approfondir et ensuite conduire l’enquête en collaboration avec les chercheurs [Schenone, 1980]. Il existe, en d’autres termes, un différend qui tient à la conception de l’enquête et au rapport établi avec les enquêtés : moyen pour aboutir à un travail de recherche sociologique qui peut se fondre dans l’action politique ou bien moment tactique pour faire émerger la subjectivité des interpellés et par là favoriser leur mobilisation ?
Ces deux visions de l’enquête renvoient également à deux positions opposées quant à l’interprétation de la théorie marxienne qui conduisent rapidement à la scission entre le groupe fidèle à Panzieri (en gros, les jeunes sociologues de Turin) et celui mené par Tronti (les groupes basés à Rome et Venise). L’objectif politique de Panzieri, au fond, est de rallier le Parti socialiste à une perspective révolutionnaire à travers l’expérimentation de nouvelles formes d’action politique s’inspirant d’une analyse approfondie de la réalité industrielle et des mutations qui ont affecté les conditions de travail. Tronti, quant à lui, vise à faire émerger le caractère « autonome » de la classe ouvrière en suscitant sa conflictualité par le biais de la recherche-action. Par là, il contribue aussi à anticiper le discours d’un vaste pan de groupes et mouvements de la « nouvelle gauche » italienne s’identifiant dans l’idée d’autonomie ouvrière [Wright, 2006, chapitre 3].
Panzieri tente de reprendre des analyses sociologiques de Marx en dénonçant l’idée, à l’époque largement répandue chez les marxistes italiens, notamment au sein du Parti communiste, d’une rationalité objective, voire neutre, de la technologie [Panzieri, 1961]. D’après Panzieri, il existe un lien étroit entre progrès technique et rapports de classes qu’il faut démystifier à l’aide de l’analyse scientifique. Le marxisme peut dans ce sens être défini comme « une sociologie conçue comme science politique, comme science de la révolution. À cette science de la révolution il faut enlever toute signification mystique en la ramenant à l’observation rigoureuse, à l’analyse scientifique » [Panzieri, 1972, p. 241]. Dans cette perspective, les thèses proposées dans les Quaderni rossi sont directement issues des enquêtes menées sur les conditions des ouvriers et sur leurs luttes. De ce fait, elles visent à solliciter la participation aussi bien des « sujets actifs » (les syndicats) que des « sujets passifs » (les ouvriers, syndiqués ou non) [Momigliano, 1962].
L’enquête ouvrière en pratique : FIAT versus FIAT
Mais de quoi parle-t-on lorsqu’on parle d’« enquête ouvrière » ? La question est moins anodine qu’il n’y paraît. Toute la production des Quaderni rossi est traversée par le thème de l’enquête, qu’il s’agisse de rédiger des comptes rendus sur les mobilisations sociales dans telle usine, de présenter les finalités et les principes qui président à la réalisation des enquêtes, de proposer et de discuter la grille des questionnaires à soumettre aux enquêtés… Concrètement, le nombre d’enquêtes publiées dans la revue est bien maigre (une dizaine) tandis que la quantité de données qu’elles fournissent n’est pas vraiment à la hauteur des objectifs.
Ainsi l’enquête menée aux usines FIAT de Mirafiori entre 1960 et 1961, qui a constitué le moment fondateur de la revue, n’a jamais été intégralement publiée et sa rédaction n’a pas été menée à terme. Nous disposons de fragments d’enquête sous forme de communication à un colloque organisé en 1961 par le Parti socialiste (qui s’appuie essentiellement sur les entretiens effectués par Romano Alquati) [Alquati, 1961], de chroniques des mouvements de grève au cours du printemps 1962 [Alquati et al., 1962], et d’un retour critique sur l’expérience de l’enquête, qui a été réalisé en 1965 par une partie des rédacteurs après la mort précoce de Panzieri [De Palma et al., 1965]. Ce dernier document est particulièrement précieux car il permet d’esquisser un bilan à la fois de l’expérience de formation et de socialisation que l’enquête sur FIAT avait représentée ainsi que du projet politique sous-jacent.
L’enquête visait à vérifier l’existence du lien entre la rationalisation capitaliste (introduction de nouvelles machines et de systèmes de planification de la production censés améliorer la productivité et les salaires) et l’intégration des salariés (adhésion aux valeurs du capitalisme et rejet de la conflictualité). Des entretiens semi-directifs furent réalisés auprès de salariés et militants syndicaux afin de pouvoir dégager, à partir de la description du travail effectué dans les différents ateliers de l’usine ainsi que des conditions environnantes, tous les éléments de tension ou d’adaptation, de conflit ou d’accord. Le guide d’entretien utilisé pour l’occasion (voir ci-dessous) cherchait à faire la part entre le souci d’objectiver les conditions de travail (rythmes et temps de travail, commandements, changements organisationnels, etc.) et la tentative de faire émerger l’autonomie des groupes ouvriers (formes de sociabilité, discussions internes ou externes à l’usine, constitution de groupes informels, etc.).
Ce qui ressort de l’enquête, c’est une réalité qui remet en cause le mythe de l’efficacité et de la rationalité de l’usine-pilote du capitalisme industriel italien : les gaspillages, l’irrationalité, la rigidité des règles, les tensions, les compromis et les arrangements sont en effet monnaie courante au sein des ateliers de Mirafiori. Ces résultats conduisent les enquêteurs à réviser certaines hypothèses de départ, tel le fait d’interpréter l’absence de conflictualité comme la preuve de l’intégration des salariés et de l’acceptation de leur aliénation ; ou le fait de considérer la tâche individuelle comme le point d’observation privilégié de l’organisation d’usine. Ce qui peut apparaître comme irrationnel ou absurde du point de vue de la tâche ne l’est pas forcément au niveau de l’organisation : d’autres logiques agissent sans pour autant éliminer les contradictions qui existent dans le travail d’atelier. Ainsi, la prise de recul offerte par le regard rétrospectif porté sur l’enquête ainsi qu’une approche sociologique plus compréhensive semblent remettre en cause les fondements du projet politique lié à l’enquête ouvrière : comment expliquer une conflictualité relativement faible comme celle des ouvriers de FIAT alors que la capacité d’intégration de celle-ci reste, somme tout, limitée ?
Guide d’entretien utilisé dans l’enquête aux usines FIAT, 1960-1961
– Depuis quand travaillez-vous chez FIAT ?
– Qu’est-ce que vous faisiez avant ?
– Comment êtes-vous arrivé chez FIAT ?
– Le lieu de travail et les personnes qui travaillent avec vous
– Qu’est-ce que vous produisez et quel rapport avez-vous avec le produit fini ?
– D’où et comment viennent les commandements ?
– Relèvement et fixation des temps.
– Discussions sur les commandements et la communication des normes et des temps.
– Si ces discussions ont été portées en dehors de l’équipe de travail et de l’usine.
– Comment est organisée la journée de travail ?
– Les camarades avec qui l’on partage les pauses ou le déjeuner ; si on les rencontre aussi en dehors de l’usine.
– La journée du travail (jugements, impressions).
– Si pendant la journée du travail on a des rapports avec des personnes qui ne font pas partie du groupe de travail.
– Changements intervenus dans son propre service et/ou département.
– Comment (et si) ces changements ont été annoncés.
– Conséquences du changement.
– Jugement sur les raisons ayant déterminé le changement et sur la rationalité de celui-ci.
– Adaptation aux nouvelles conditions de travail et possibilité de neutraliser les conséquences négatives.
– Fréquence et intensité des changements et nombre de personnes impliquées.
– Discussions communes et tentatives d’organisation informelle ou refus de considérer le problème et intégration passive.
– Discussions portées au sein des commissions internes [5] et des syndicats.
– Organisations autonomes ou dépendantes.
– Compromis avec la direction.
– Bonus, primes, structures d’assistance.
– Problèmes de mobilité interne, déplacements, qualifications, tâches.
– Aspirations à changer de poste de travail, soit dans l’immédiat soit sur le long terme.
– Si les organisations informelles au sein de l’usine aident à la constitution de groupes à l’extérieur ayant des intérêts divers.
– Si l’on rencontre des ouvriers d’autres usines, de quoi l’on parle.
– Si le système de valeurs offert à l’extérieur de l’usine est susceptible de compenser les insatisfactions qu’on expérimente à l’intérieur : consommation, activités culturelles, récréatives, politiques, etc.
Si les sociologues professionnels ont eu beau jeu de critiquer le déficit de scientificité des enquêtes réalisées par le groupe des Quaderni rossi, et tout particulièrement celle sur FIAT (construction peu rigoureuse de l’échantillon des interviewés, opacité des données issues de l’enquête, etc.) [Bonazzi, 2000, p. 29-39], il ne faut pas oublier le caractère militant de cette expérience qui, au final, était prédominant. Parmi les résultats à prendre en considération, il y a donc aussi ceux de nature politique qui s’expriment en termes de capacité de mobilisation, de prise de conscience de la part des enquêtés, d’élaboration de formes d’action politique, de réactualisation des relations avec les organisations syndicales. Là encore, l’autocritique menée par les auteurs de l’enquête chez FIAT offre l’occasion de repenser ses fondements méthodologiques et politiques. Le problème central est représenté par la double ambiguïté qui ressort du travail d’agitation politique visant à réveiller la conscience politique des ouvriers : d’une part, la conscience politique est vue comme un objectif à atteindre, d’autre part elle est considérée comme inhérente aux comportements ouvriers de conflit et de protestation. Ainsi, elle est à la fois le but et la prémisse de l’action de recherche militante :
Souvent – relèvent les auteurs – le lien entre l’analyse de la condition ouvrière et la proposition de revendications était plutôt forcé et artificiel : on ne peut pas dire, par exemple, que les revendications en matière de qualifications exprimaient une critique adéquate de l’évaluation déformée que l’on donne du travail ouvrier au sein de l’usine ; souvent, en d’autres termes, l’exigence de trouver à tout prix un débouché revendicatif prévalait sur la rigueur politique.
[De Palma et al., 1965, p. 251].
En fait, il s’agissait moins d’une enquête ouvrière que d’une enquête sociologique sur la classe ouvrière, car les salariés prenaient part à l’activité de recherche de manière marginale, en tant que contacts préliminaires (normalement filtrés par les canaux syndicaux traditionnels), à partir desquels les chercheurs élaboraient, de l’extérieur, leurs hypothèses de travail. Romano Alquati (1935-2010), sociologue, collaborateur de Montaldi et longtemps animateur de la mouvance opéraïste, en présentant en 1975 ses multiples recherches sur FIAT et d’autres réalités industrielles, souligne les limites d’une démarche dont l’interprétation ne faisait pas consensus. S’opposaient en effet ceux qui voyaient dans le rapport avec la base ouvrière un moyen pour faire de la recherche sociologique une activité militante et ceux qui pensaient l’enquête comme un moment provisoire en vue de l’organisation de formes politiques « autonomes » au sein des ateliers [Alquati, 1975].
C’est le même Alquati qui, après l’expérience des Quaderni rossi, continue à s’intéresser à la condition ouvrière dans les usines FIAT. À partir d’un travail de terrain très riche – qui combine historiographie, sociologie du travail et ethnographie urbaine –, il s’efforce de comprendre la culture ouvrière en interrogeant le poids du filtre de la mémoire sur les différentes générations d’ouvriers, les cultures propres aux lieux de travail ou, encore, les aspects « invisibles » inhérents aux multiples pratiques de contestation ouvrière comme le sabotage. L’accent est mis sur les « unités élémentaires » de résistance ouvrière qui prennent appui sur l’organisation du travail mais aussi sur les réseaux sociaux opérant à l’intérieur comme à l’extérieur de l’usine [Alquati, 1965a et 1965b]. Ainsi, une fois débarrassé des contraintes issues de l’affrontement idéologique qui avait traversé l’expérience de l’opéraïsme, Alquati revient aux enseignements de Montaldi sur l’importance d’étudier les classes subalternes dans leurs propres univers culturels tout en essayant de dénaturaliser les catégories politiques qu’on a tendance à leur attribuer.
Cette démarche anticipe les apports de l’histoire orale et de l’histoire de la sociabilité ouvrière qui sont au cœur du renouvellement des études sur le travail et le mouvement ouvrier durant les années 1970 et 1980 [Musso, 2009], alors que la sociologie, à quelque exception près, abandonne toute tentative de problématisation de la culture ouvrière et de la « conscience de classe » dans un contexte de progressive institutionnalisation et spécialisation de la discipline [Beccalli, 2007].
Conclusion
La trajectoire politique et intellectuelle de l’opéraïsme italien durant sa première phase, au tournant des années 1960, est marquée par la relation entre le militantisme politique et la recherche scientifique. La formule de « l’usage socialiste de l’enquête », forgée par Raniero Panzieri, restitue de manière efficace l’ambition de mettre au service de l’action politique le travail d’investigation et, en même temps, de donner à celui-ci une dimension politique. C’est dans cette dialectique que réside la spécificité d’une expérience comme celle des Quaderni rossi, qui bousculent le champ de la « nouvelle gauche » italienne. La proposition méthodologique d’un pionnier de l’enquête militante comme Danilo Montaldi, s’inspirant des marxistes hétérodoxes de Socialisme ou Barbarie, est à la base des discussions entamées lors de la constitution de la revue et se traduit par la valorisation de la notion de conricerca (recherche en commun). En rassemblant les enquêteurs et les enquêtés autour d’un projet politique partagé, les Quaderni rossi ont essayé de donner de l’épaisseur à ce projet en faisant redécouvrir à la classe ouvrière sa vocation révolutionnaire par rapport à des problèmes tels que le progrès technique ou l’intégration des salariés aux valeurs du capitalisme. Panzieri a ainsi entendu récupérer le caractère sociologique du marxisme en s’appuyant sur l’analyse scientifique de la réalité industrielle. Les interprétations successives ont repris le discours sur la formation de la « conscience ouvrière » en faisant de l’enquête un moyen d’intervention directe dans la lutte politique. Enfin, la prise de distance critique avec les enquêtes réalisées sur le terrain a permis, d’une part, de remettre en cause la scientificité de certaines notions issues du travail à la fois de recherche et de mobilisation et, d’autre part, de revaloriser la dimension politique de la recherche tournée vers les univers culturels et les formes de sociabilité des classes subalternes. Cette deuxième option a ouvert une piste féconde pour jeter les bases d’une sociologie critique du travail, dont les présupposés à la fois politiques et épistémologiques sont loin d’être épuisés.
Notes
Archivio di stato di Cremona (ASC), Cremone, Fondo Montaldi, b. 32, f. 2, note dactylographiée, s.d.
ASC, Fondo Montaldi, b. 32, f. 3, note dactylographiée, s.d.
ASC, Fondo Montaldi, b. 30, f. 6, « Un’inchiesta nel cremonese », Opinione, 1956, n° 2.
ASC, Fondo Montaldi, bb. 29 et 31.
Instances de représentation syndicale au sein des usines.
Mis en ligne sur Cairn.info le 06/12/2019